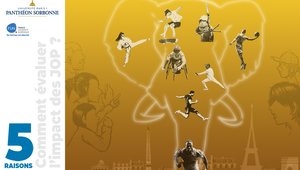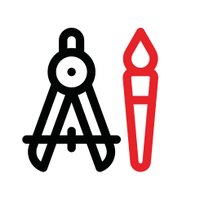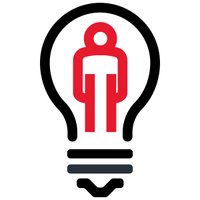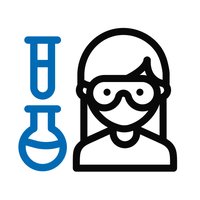Se former en liberté
Des cours en ligne pour découvrir, apprendre, progresser et réussir
Chercher dans nos cours
Explorer notre catalogueCours à la Une
 CatégorieCertifiant
CatégorieCertifiantActualités
Améliorez les performances et la rentabilité de votre entreprise
22 avril 2024
Catégories
Autour du coursDéveloppez la maîtrise de votre entreprise c’est-à-dire votre capacité à gérer les activités et les informations au sein même de votre filière de production.
5 raisons de suivre le MOOC CARE management pour soi et ses équipes
19 avril 2024
Catégories
Autour du coursQuelles solutions pour transformer son travail aux niveaux individuel, collectif, social et environnemental ? Le Cnam propose un cours à la croisée du développement personnel, du management et de l’économie de transition.
Bienvenue dans le nanomonde
18 avril 2024
Catégories
Autour du coursPlongez au cœur de l'infiniment petit avec un MOOC qui dévoile les étonnantes possibilités des nanotechnologies. Explorez les innovations qui transforment notre quotidien aux confins de la technologie, la physique, la chimie et la biologie.
5 raisons de suivre le MOOC «Science et entrepreneuriat : les fondamentaux»
11 avril 2024
Catégories
Autour du coursPour un-e scientifique, entreprendre, c'est s'engager et renforcer l’impact de sa recherche sur la société. Découvrez comment passer à l’action avec l’IRD et Kedge Business School.
5 raisons de suivre le MOOC «Comment évaluer l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques ?»
11 avril 2024
Catégories
Autour du coursCombien coûtent les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Quelles retombées peut-on en espérer et dans quels domaines ? Voici un cours qui analyse les enjeux économiques, sociaux et territoriaux liés à l'organisation de ce méga-événement.
Thématiques & Collections
Choisissez parmi nos thématiques et collections de MOOC. De nouveaux cours sont ajoutés tous les jours